

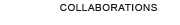


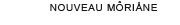


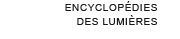
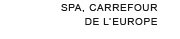
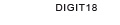
|
|
E-bibliothèque > Articles
Raynal à Liège : censure,
vulgarisation, révolutions[*]

Par DANIEL DROIXHE
Dans une postface à son livre Diderot, de l'athéisme à l'anticolonialisme (Paris 1981), Yves Benot, répondant à l'accusation d'avoir exagéré l'intention «pré-révolutionnaire» dans l'Histoire des deux Indes, invoque la manière dont l'œuvre, en son temps, fut reçue par les autorités[1] :
Il serait bon, à cet égard, de se reporter au réquisitoire de Séguier en 1781 et à l'arrêt du Parlement. Ceux-là, en effet, ont procédé à une lecture directe et ont sorti du livre les passages subversifs qu'ils citent d'ailleurs (car c'est un des paradoxes de la censure au XVIIIe siècle que de trouver dans les arrêts de condamnation des livres interdits par le Parlement un résumé correct de ces mêmes livres, en vente légale, celui-là!); c'est-à-dire que, sans s'arrêter aux explications possibles, ce qu'ils y ont perçu immédiatement, outre l'attaque contre l'Église, c'est bien l'appel à l'insurrection en France même.
L'idée d'une diffusion majeure de la pensée de Diderot-Raynal par des relais que fournit le camp adverse s'impose, à la vérité, assez naturellement, bien qu'elle traduise une réalité si banale qu'on se demanderait comment le pouvoir et l'Église ont pu se laisser prendre à un tel piège, sans nécessité. Elle a été reprise dans une perspective qui met davantage l'accent sur la transmission d'un certain vocabulaire et d'un appareil choisi de citations[2]. On y rappelle l'arrêt du Conseil d'État supprimant en 1772 la première édition de l'Histoire, la condamnation du Parlement de Paris évoquée plus haut, avec le réquisitoire de Séguier, et la censure contemporaine de la Faculté de théologie, en écrivant à leur sujet :
Il peut sembler paradoxal de soutenir la thèse selon laquelle une large réception sociale des énoncés les plus hardis de l'HDI s'effectua en partie grâce à la publication de ces trois textes de censure, à travers leur diffusion dans les journaux de l'époque, et surtout à travers la lecture publique du Mandement de l'archevêque de Vienne dans les églises de France en 1781. Les conséquences de cette publicité inintentionnelle ne se matérialisèrent pas seulement dans une curiosité avivée du public et une vente accrue des éditions clandestines, mais aussi au moyen de la diffusion renforcée d'un ensemble très réduit et radicalisé d'énoncés et de mots-clefs sociopolitiques extraits de l'HDI.
Le débat entre Y. Benot et R. Mortier l'avait déjà rendu manifeste. Les provocations du livre, souvent inspirées par l'«ivresse langagière» de Diderot, ont focalisé l'attention au point de le transformer, plus que tout autre ouvrage du dix-huitième siècle (songeons par comparaison au Contrat social), en un chapelet de passages «forts» éventuellement ramassés en slogans, «discours révolutionnaire [qui] se détache et se grave dans l'esprit d'autant plus fortement qu'avant et après, le récit historique, même parsemé de remarques philosophiques, poursuit son cours[3]».
Que les héritiers de Raynal, ceux par exemple de 1789 qui le désigneront comme un «professeur en insurrections[4]», aient essentiellement retenu la tonalité dominante que constituent ces passages, qu'ils aient d'abord été sensibles au «mouvement du discours» et au lexique ou l'auteur se «transmue en révolutionnaire jacobin» — par un jeu rhétorique qui ne l'est plus dès qu'il entre dans les faits — quoi de plus normal? Que la censure ait elle-même sélectionné, organisé et surtout popularisé les «déclamations» les plus séditieuses, c'est ce que les répercussions de l'affaire de l'Histoire des deux Indes à Liège montrent bien, nous semble-t-il, la principauté ayant peut-être par rapport à d'autres régions l'avantage de son cléricalisme d'État. Le type de diffusion illustré par le mandement de l'archevêque de Vienne, les condamnations officielles ou privées de Raynal, comme celle due à François Bernard, dont il sera question, et les tensions travaillant l'autorité apparaissent ici amplifiées: par l'indulgence ou la complicité d'un prince-évêque franc-maçon, symbole d'un haut clergé mondain et moderniste; par la hargne d'un synode qu'une lettre prétendument signée de Raynal appelait un «tribunal fantastique, dont le modèle n'existe que dans les siècles de ténèbres»; par une presse, enfin, et une imprimerie florissantes qui avaient trouvé au nord de la France, dans le pays de Liège, à Maastricht, Bouillon ou Luxembourg, d'excellentes conditions de développement[5].
La principauté se signale également, sur le chapitre de Raynal, par deux types de document permettant d'appréhender de façon concrète une certaine vulgarisation, au moins virtuelle, du débat relatif à l'Histoire des deux Indes. G. de Froidcourt[6] a bien raconté le séjour de l'abbé à Liège et à Spa, au lendemain de la condamnation de mai 1781, les remous produits par l'éloge que lui adressa le futur révolutionnaire Nicolas Bassenge, alors âgé d'une vingtaine d'années, et la conduite du prince-évêque Velbruck, qui honora le premier en le recevant ouvertement et fit le maximum pour protéger le second contre les fureurs du synode. Raynal arriva portant l'auréole du philosophe proscrit. Il est vrai que le Raynal démasqué de 1791 présentera les choses sous un autre jour. Peu considéré chez les écrivains français, l'«auteur putatif» de l'Histoire des deux Indes aurait profité d'une flatteuse persécution pour se mettre hors de portée des critiques et jouir à son aise de la réputation faite au livre[7]. Il «chercha donc la province et l'étranger». Quoi qu'il en soit de ces circonstances, déformées ou non par l'hostilité que lui valut son revirement de 1791, on eut aussi l'impression, à l'étranger, que la fuite de l'abbé n'en était pas tout à fait une, et qu'elle avait pu être favorisée en haut lieu : «Cet écrivain si justement célèbre fut en effet reçu avec distinction par M. Sabathier, ministre plénipotentiaire de France [à Liège], qui n'aurait pas admis dans sa société un homme que sa patrie eût regardé comme vraiment proscrit[8].» «Son Altesse Celsissime désira que M. l'abbé Raynal lui fût présenté; il eut l'honneur de manger plusieurs fois avec Elle.» On ne reviendra pas ici sur l'aspect le plus discuté de l'«affaire» : le comportement du prince, qui, malgré son indépendance d'esprit et de caractère, dut se résoudre fin octobre à signer un mandement condamnant Bassenge, sa Nymphe de Spa à l'abbé Raynal et le «souffle empoisonné» de celui-ci, afin d'enrayer la «funeste épidémie» de l'irréligion, «qui partout ailleurs fait les plus grands ravages». Il suffit, pour se faire une idée des sentiments intimes du prélat, de rappeler la lettre qu'il adressait peu auparavant au bourgmestre Jacques-Joseph Fabry, qu'on va retrouver : « Le célèbre abbé Raynal n'a rien écrit qui peut m'offenser. Les raisons qu'on a de le proscrire en France me sont étrangères, et quand les réquisitions me seront parvenues de le proscrire dans ce pays ici, je les pèserais, et verrais ce que je répondrais.» Une lettre adressée au chef du synode, souvent citée, se prononçait dans le même sens à propos de l'épître de Bassenge, par laquelle le scandale était arrivé : « Je n'y trouve rien ni contre la religion ni contre les mœurs et je pense que tout bon esprit en jugera ainsi. Si l'auteur y loue l'abbé Raynal, c'est sans adopter ses erreurs, c'est comme homme de lettres et nullement comme théologien.»
Ainsi se développa contre le philosophisme, en particulier par l'action de synode, une campagne qui nous a d'abord laissé divers poèmes en français et en dialecte wallon. Seuls ces derniers[9] vont nous intéresser dans ce qui suit : deux chansons de ton populacier qui désignent explicitement Raynal et Bassenge; une pièce, également assez courte, où le «fantôme» d'un chanteur de rues bien connu sermonne le disciple liégeois; et un long Discours sur les esprits forts de ce siècle, de caractère général, qui peut être rapporté aux événements de 1781, sans qu'il y fasse une allusion directe.
É. Hélin a par ailleurs attiré l'attention[10] sur un dialogue français inédit, trouvé dans les dernières pages d'un registre paroissial, où un personnage appelé «le Paysan» attaque un partisan de Raynal dont le nom, «Paul Cadet» déguise à peine la personnalité de Bassenge. Quant au Paysan, il se définit d'un trait quand il prend congé de son adversaire: «Adieu […] Puissiez-vous avoir une petite chaumière où, comme nous, vous eussiez du bon sens et de
la religion.» L'auteur
de cette conversation «apocalyptique» est un membre du «tribunal fantastique» évoqué plus haut: Gilles Légipont, curé de la populeuse paroisse Saint-Georges à Liège, examinateur synodal et président de l'Académie anglaise sous le règne de Velbruck. L'historien J. Daris lui attribuait la rédaction d'un «ouvrage contre Raynal» qui ne fut pas publié. On peut croire que le Dialogue entre Cadet et le Paysan en formait une partie, ou le noyau. Ce texte seul justifierait déjà qu'on revienne sur une «affaire Bassenge-Raynal» qui a peut-être été ressassée, dans l'historiographie liégeoise, mais qui n'est pas classée pour autant, parce que, comme la Société libre d'Émulation (1779) où se distingue déjà Bassenge, elle ne prépare pas seulement 1789 par la continuité des acteurs historiques. Il est difficile de parler ici d'un simple finalisme scolaire, à propos de la liaison établie entre ces divers événements, quand on considère ce qui est au centre de l"affaire', c'est-à-dire le texte de l'Histoire des deux Indes. Sa violence suffit à expliquer celle des attaques dirigées contre Raynal. Élargi à d'autres écrits et informations susceptibles d'atteindre l'homme moyen, ce discours politique nouveau rend compte du poids de l'épisode de 1781 et donne à son enjeu sa valeur prophétique.
1. LA DISTRIBUTION DES THÈMES
Les tirades de collège que Légipont a mises dans la bouche de son paysan abondent en stéréotypes, en procédés rhétoriques dont É. Hélin a fourni un premier dénombrement, avec celui des mots les plus fréquents : irréligion, licence-obscénité-impudicité-saleté, chimère-délire-extravagance-folie, chaos-fatras, etc. Le curé, on le devine, n'a pas la main légère. Ses sarcasmes répondent mal à l'ironie de l'adversaire. Sa déclamation ignore totalement les «mécanismes de la persuasion clandestine», où la «propagande se fait à demi-mots».
Dans le Dialogue, comme dans les écrits en dialecte, l'attaque se concentre d'abord autour du motif du libertinage, avec ses deux faces : religion et morale. Mais si la chanson wallonne accentue le deuxième aspect, qui offrait à sa verve satirique toute la matière désirable, le Dialogue fait une place également importante, comme l'ensemble de la censure religieuse, au troisième volet critique de l'Histoire des deux Indes, la mise en cause de l'autorité civile. L'Église tint en effet à afficher le lien organique l'unissant à l'État. Cette façon d'assumer la réalité, qui n'était peut-être pas de la meilleure tactique, sera bien illustrée par l'Analyse de l'Histoire philosophique de Bernard.
Si l'ancien régime a jeté toute son unité dans la bataille provoquée par Raynal, c'est bien sûr parce qu'il a subi — avec une force apparemment inconnue jusqu'alors — une offensive visant le cœur du système et s'appuyant non sur un projet utopique éventuellement marqué de religiosité ancienne (comme chez Deschamp ou Morelly), mais sur un appareil de faits concrets relatifs à cette discipline toute moderne qu'était l'économie politique. La religion avait aussi son économie, qui était pour une bonne part devenue terrestre. Le théâtre des récompenses et des châtiments s'était déplacé. Dans le Dialogue, le militant chrétien a rejoint sur leur terrain ceux qu'il combat. «Légipont voit Raynal avec des ongles longs et crochus, mais il se garde bien de prononcer les mots d'enfer et de paradis. L'apologiste d'une religion révélée ne parle point de péché ni de salut[11]. « Le désordre social a remplacé les tourments de l'au-delà, auxquels on ne croyait plus.
Le bouleversement universel prend des formes diverses dans la littérature de propagande diffusée à Liège. Visant plutôt l'aspect moral, les pasquilles wallonnes imputent aux libertins le dessein de faire aller les autres et le monde so s'cou so s'tièsse, «cul par-dessus tête», mais les plaisanteries désamorcent toujours un peu
la charge. La
mise en scène est mélodramatique chez Légipont, avec lueurs infernales sur fond de ruines. Attirail qu'un Liégeois pouvait croire bien fait pour toucher ses concitoyens, chez qui la sensibilité pré-romantique n'était pas un vain mot : il suffit de penser à Grétry. «Que le tonnerre de Raynal, selon l'expression de l'insensé poète [Bassenge], gronde, que les éclairs brillent et serpentent dans les airs, que l'orage crève, le monde est perdu[12].» On conviendra que ces hauts cris n'animent pas beaucoup un débat où le sage Paysan, comme on l'a remarqué, «monologue quatre pages sur dix». La vivacité vient au contraire de certains passages de l'Histoire des deux Indes reproduits par Légipont, ceux où Diderot s'enflamme[13]. Leur éloquence naturelle les détache. Le lecteur censé assister à un dialogue pouvait trouver en eux les caractères d'une parole plus directe et plus persuasive.
Ces passages, en général, venaient eux-mêmes du choix opéré par
la censure. Un
premier tri avait été présenté par François Bernard dans une Analyse de Raynal publiée en 1775. Cette critique se réfère à la deuxième édition de l'Histoire, «qui vient de paraître à La Haye». Elle fournit du reste quelques renseignements sur la première de 1770 (qu'elle dit imprimée à Paris) et sur le «succès prodigieux» qu'a connu l'œuvre «dans toute l'Europe», comme l'attestent les «contre-factions». L'Analyse se donne pour un simple recueil de ses propos les plus scandaleux, extraits «avec la plus exacte fidélité». L'auteur adopte tout de suite un profil bas. Sa lutte est celle de l'homme de foi, de bonne foi simple et sans éclat, en butte aux philosophes mondains, aux beaux parleurs. «Ma glose peut être défectueuse», «mes raisonnements peuvent être faibles» : quel contraste avec «le ton décisif et imposant des nouveaux oracles du genre humain». Bernard s'est «permis à la vérité quelques réflexions». «Mais ce sont des idées à moi qui pourraient ne paraître pas bien justes à tout le monde.» Ici, l'apologiste prend un ton en deçà de celui qui conviendrait pour faire jeu égal. Ailleurs, il a conscience d'avoir outrepassé. Le lecteur «sera peut-être surpris des expressions fortes, ou plutôt des qualifications déshonorantes» qu'il emploie contre Raynal, qui les a pourtant méritées. L'adversaire des philosophes s'éprouve désaccordé aux modes d'argumentation, au langage de son temps. Il est vrai qu'il y a dans ces prudences une bonne part de coquetterie. François Bernard discutera autant qu'il cite. Le débat se développe à l'aise entre les contradictions qu'on prétend relever chez Raynal.
La réfutation donne ensuite ses buts : «faire l'apologie de la raison, du bon ordre, des lois, et surtout de la religion chrétienne.» Le clin d'œil à la raison visait un public qu'on sent gagné de plus en plus aux valeurs du jour; la priorité de la religion servait peut-être davantage à se convaincre soi-même. Dans de nombreux passages, en effet, elle n'est pas si manifeste que le souci du «bon ordre» moral et social. Les premières pages de l'Analyse ont des tirades sur la manière intolérable dont Raynal «a violé les règles de la bienséance, de la modération, du devoir et du respect envers les Potentats de la Terre», sur le fait d'avoir «insulté dédaigneusement à la soumission des sujets envers les Souverains». «Un cœur vrai, droit et vertueux peut-il voir sans émotion le Fanatisme mettre la torche ardente à la main de tous les peuples de l'Univers, pour l'embraser, sous prétexte d'y rétablir une égalité parfaite entre tous les hommes sans distinction? Peut-on voir de sang-froid ces prétendus Sages du monde affermir dans la main des sujets le poignard meurtrier, et les encourager à l'enfoncer dans le sein de tous les Souverains de la Terre[14]…?»
La perspective de l'embrasement est aussi celle qui s'impose à l'abbé François-Xavier de Feller quand il rend compte de l'Analyse dans les numéros de février et de mars de son Journal historique et littéraire, imprimé à Luxembourg avant de l'être à Liège et à Maastricht à l'époque de la Révolution[15]. Dans cette image de Raynal qui présente un deuxième degré de réfraction, avec un pouvoir de diffusion sans doute supérieur encore à celui de l'Analyse, comme on peut l'attendre d'un journal, une place prédominante est accordée à la défense de l'ordre civil par rapport à celle de la religion ou de
la morale. C'est
que la «haine» du christianisme n'est plus une nouveauté. «Malgré le ton original qu'il sait prendre avec succès, [Raynal] n'a pas dédaigné d'être l'écho de ce peuple de vils écrivains qui depuis quelques années copient servilement des injures usées et déshonorent la littérature par des emportements aussi ridicules qu'inutiles.» L'«éloge du vice» est aussi entré dans les habitudes, en particulier avec Helvétius. Mais on est moins accoutumé, manifestement, à voir un écrivain mettre «entre les mains des sujets la torche et le glaive», en développant dans toutes ses conséquences une «doctrine sur la liberté des peuples qui tend à la ruine de tout gouvernement». «Les principes y sapent les fondements de la société humaine; en les adoptant, on amènerait toutes les horreurs de l'anarchie la plus destructive, et le monde politique serait livré sans ressources et sans retour à l'embrasement le plus inévitable et le plus général.»
L'Analyse avait paru la même année sous deux adresses : celle d'«Amsterdam et Paris, Morin» et sous le nom de J. Murray, à Leyde. C'est cette dernière édition que le libraire liégeois François-Joseph Desoer met en vente, comme l'a signalé G. de Froidcourt. Le compte rendu de Feller indiquera de son côté que l'ouvrage se débite «à Liège, chez Boubers et chez Desoer». Celui-ci ne manquera pas d'annoncer la vente du livre dans la Gazette qu'il publie par ailleurs, sorte de semi-quotidien qui comportait une part d'avertissements locaux, à côté des informations internationales faisant l'essentiel du journal. Après une publicité soutenue à la fin de janvier, l'un ou l'autre rappel parut encore jusqu'au mois de mai, tandis que de nouveaux ouvrages prenaient la vedette[16]. La Gazette insistait tout de suite sur l'intérêt d'un tel recueil, pour l'amateur un tant soit peu pressé. «Ce livre, dont l'acquisition est nécessaire à ceux qui se sont procuré ou ont lu le célèbre Ouvrage Philosophique, etc. est très-utile aux autres, qui s'épargneront les frais et la lecture de l'ouvrage complet en 7 vol.» On ajoutait un commentaire dont l'ambiguïté devait sembler piquante à ceux qui avaient entendu parler du «célèbre ouvrage» : «Cette analyse a pour objet la religion, la société, la morale, la tranquillité publique, la juste subordination, la paix intérieure de l'homme et sa félicité.»
Ces annonces apparaissaient dans un contexte dont il faut dire un mot parce qu'il donne une de ses résonances à l'Histoire des deux Indes, dans une province pour laquelle nous savons finalement très peu de chose de la manière dont le public lettré a pu ressentir telle ou telle idée de Raynal. La réception se borne en général à la condamnation, sur un modèle dicté par
la censure. Condamnation
souvent mécanique ou massive. Mais des textes aussi neutres que celui de la Gazette de Liège — qui se gardait soigneusement de «faire de la politique» — produisent malgré tout, autour des écrits soumis à contestation, des effets que nous pouvons considérer comme éprouvés par le public contemporain. Les nouvelles du nouveau monde constituent à cet égard, pour l'Histoire des deux Indes, un arrière-fond des plus parlants.
2. LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE EN LECTURE CROISÉE
Les informations concernant la rébellion des Bostoniens et de leurs émules figurent en bonne place dans la Gazette, où elles forment un feuilleton à péripéties «qui deviennent tous les jours plus intéressantes» (numéro du 22 juillet 1774). R. Comoth a aussi noté, à propos d'autres journaux bien représentés dans la région, qu'elles «frappent par leur abondance, souvent même par leur minutie[17].» C'est le cas du Journal historique et littéraire de Feller, du journal historique et politique et du journal encyclopédique de
Pierre Rousseau
, à l'époque respectivement imprimés à Luxembourg, Liège et Bouillon, sans parler de l'éclectique Esprit des journaux, qui se partageait entre Liège et Bruxelles, comme entre les opinions politiques les plus diverses.
La Tea Party
se généralisant, on commence à penser, devant la mobilisation des colonies américaines, que «l'idée de la formation d'un empire au nouveau monde n'est ni impraticable, ni fort éloignée, quoiqu'on se persuade ici à Londres qu'un tel événement ne saurait avoir lieu» (15 juin). Les lecteurs de la Gazette n'en étaient pas moins avertis, en cet été 1774, «que tout espoir d'accommodement avec l'Angleterre avait cessé» (24 août), même si on voit circuler tel ou tel «plan de réconciliation entre la Grande-Bretagne et les colonies». On relate bientôt des troubles qui pourraient n'être «que le prélude des violences qu'on s'attend à voir éclater dans ces quartiers-là». Sans modération de part et d'autre, on prévoit «que l'embrasement sera général» (17 octobre). Après l'hiver, les nouvelles se précipitent. Les esprits s'animent en Caroline et en Virginie, les rebelles déploient «l'étendard de la Liberté à Salem». On apprend avec un mois de retard l'annonce des affrontements de Lexington (28 avril, 5 mai, 12-14 juin 1775).
Sur ces événements, le journal évite d'exprimer ou de reproduire aucune opinion. Mais il les rapporte dans des termes qui se réfèrent aux valeurs montantes et dont le sens positif est souligné par d'autres passages, tandis que d'autres nouvelles encore font ressortir — en tout cas pour le lecteur moderne — le conservatisme et la sclérose de bien des habitants du vieux monde. Le numéro du 18 janvier 1775 de la Gazette de Liège, par exemple, rassemble encore le vocabulaire de l'autorité à propos des nouvelles de Boston et de Salem. Les choses sont dites dans le langage de la métropole et de
la tradition. La
conduite des Américains est «illicite et séditieuse», leurs proclamations invitent «au parjure, au désordre, à la sédition, à la trahison et à la révolte». Le journal du 23 janvier qualifie celles-ci bien différemment, en rapportant que «le congrès de la province de Massachuset» approuve «toutes les résolutions du congrès général de Philadelphie, comme fondées sur les lois immuables de la nature et de la raison». Du côté des insurgés, on fait appel à «l'humanité de la nation britannique». L'autorité civile, chez eux, s'établit et se vit aussi de façon différente. Ils l'ont placée «entre les mains d'une commission de 40 personnes élues par le peuple» (19 avril). Ils poursuivent d'autre part «leurs efforts pour former une armée formidable qui soit capable de les soustraire au joug de l'esclavage, auquel ils prétendent qu'on voudrait les asservir». Car «toutes les nouvelles des colonies confirment de plus en plus leur résolution de décider par les armes la grande dispute entre elles et l'Angleterre» (5 et 7 juillet).
À partir de là, les justifications des rebelles seront régulièrement reproduites. À Londres, la Cour aurait ordonné de détruire «par le feu toutes les villes qui auront pris les armes» : on prépare les désolants tableaux de Candide. Pourtant, en Angleterre même, l'opposition Whig avec Pitt et Burke invoque contre les erreurs politiques de la couronne les principes les plus forts, en s'adressant au roi. «Vos sujets américains, Sire, descendus des mêmes ancêtres que nous, paraissent également jaloux des prérogatives d'hommes libres, sans lesquelles ils ne peuvent s'estimer heureux.» Bonheur, volonté collective : le journal égrène en douceur par la citation les thèmes les plus opposés à la «violence», au «sang», à la «contrainte, incompatible avec un gouvernement libre» (26 juillet).
Ce langage prend d'autant plus de relief qu'il est pour ainsi dire renforcé latéralement par d'autres nouvelles. Tandis que les synodes d'York et de Philadelphie, interprètes des vœux de la nation, invoquent «l'humanité», la gazette célèbre la «bienfaisance éclairée» d'un curé du pays de Dijon, vrai «Pasteur-Citoyen» dont «la vie est un tissu de bonnes œuvres religieuses et patriotiques» (30 août). Comment ne pas rapprocher sa «vertu», qualité sociale qui «semble quelquefois être toute puissante», de l'esprit animant les Américains dont une colonne voisine, dans le même journal, dit qu'ils «paraissent déterminés à sacrifier leur vie, leurs biens et tout ce qui leur est cher au maintien de leurs droits et privilèges»?
À leurs revendications de liberté font écho les articles qui rapportent, sur la fin de l'été, l'action spectaculaire menée par Malesherbes en faveur de certains embastillés. On communique de Paris qu'il 'a résolu de visiter toutes les prisons de cette ville, pour voir et interroger ceux qui y sont détenus par des ordres du roi» (ter septembre). A la Bastille, il a
fait amener devant lui tous les prisonniers. Il les a placés en deux lignes, ceux contre lesquels il n'y avait point de charges déterminées d'un côté, et de l'autre ceux contre lesquels il y avait des accusations formées. Il dit plaisamment aux premiers : Mes amis, vous ne savez donc pas ce que vous avez fait? Ma foi, ni moi non plus : ainsi soyez libres; sortez quand vous voudrez. [4 septembre]
On ne pouvait mieux illustrer l'arbitraire d'un pouvoir dont l'autoritarisme faisait cause commune avec l'intransigeance du roi d'Angleterre, également rapportée en détail par la Gazette de Liège, où l'on avait dit le «pathétique» des appels qui lui avaient été lancés, en un temps où les Américains espéraient «tout de la sagesse, de la justice et de la bonté du Souverain» (24 mai).
Il faudrait ici montrer quel triple contraste offraient, dans la Gazette, le volet d'informations «libérales» qu'on vient de décrire, celles en provenance de Versailles ou de la Cour de France et les nouvelles du peuple. Ce qui s'en dégage tient en trois mots : émancipation, sclérose, misère. On comprend mieux, alors, l'effet qu'a pu produire cet élargissement des perspectives qui, au livre xviii de l'Histoire des deux Indes, donne à considérer les pauvres comme les «nègres de l'Europe» selon la formule de Chamfort.
Dès la première édition, les termes de généralisation — toutes les nations, toute société raisonnable, bouleversement universel, etc.[18] — élèvent vers le droit naturel et inscrivent dans un futur qu'on sent proche, autour de l'idée de liberté, une série de principes qui vont au-delà de celle-ci et de sa conception abstraite. Le refus, par les Américains, de l'impôt du timbre «doit servir d'exemple à toutes les nations qui se sentiront foulées par les abus de l'autorité». Le propos figurera au chapitre 19 de la deuxième édition[19] : La métropole a voulu établir des impôts dans les colonies de l'Amérique septentrionale. En avait-elle le droit? Le passage correspondant se trouve au chapitre 40 de la troisième édition, sans cette phrase[20]. La «liberté», pour les colonies, «de s'imposer elles-mêmes les taxes qui concourent au revenu public» devient une «prérogative naturelle et conforme au but fondamental de toute société raisonnable». À propos du Parlement anglais, paradigme de l'institution politique moderne, on demande ce qu'il vaudrait s'il était «héréditaire et permanent, ou même arbitrairement créé par le Roi», s'il prenait des décisions «sans consulter l'opinion publique ni la volonté générale». La question ne peut que rejaillir sur
la France. Comme
la suivante : comment appeler une nation privée de ces procédures démocratiques?
Aucune société n'a conservé une ombre de liberté, dès qu'une fois elle a perdu le privilège de voter dans la sanction et la promulgation des lois fiscales. Une nation est à jamais esclave, quand elle n'a plus d'assemblée ni de corps qui puisse défendre ses droits contre les progrès de l'autorité qui la gouverne[21].
Les dernières pages consacrées aux colonies américaines dans les éditions de 1770-1772 et de 1774, presque identiques sur ce point, font habilement culminer le glissement des pronostics sur le nouveau monde en direction de l'ancien. La question qui se pose, et à laquelle l'actualité, pressent-on, pourrait donner une réponse imminente, est de savoir jusqu'où les colonies doivent pousser leur résistance aux impositions (chapitre 31). Corrélativement, on se demande s'il leur serait utile de rompre les liens qui les unissent à la métropole et si les nations de l'Europe doivent travailler à rendre les colonies anglaises indépendantes (chapitres 32-33). Après avoir mis celles-ci en garde contre le «très-grand malheur» que constituerait vraisemblablement «un divorce éternel» et après avoir pris la précaution de distinguer leur légitime «résistance» de la «fureur d'un peuple soulevé contre son souverain», on conclut, de manière quelque peu contradictoire, au caractère inévitable d'un «grand démembrement». «Tout y achemine; et les progrès du bien dans le nouvel hémisphère, et les progrès du mal dans l'ancien.» Le processus associe étroitement les deux continents, laissant l'ombre du «déchirement» s'étendre de l'un à l'autre. Puis l'ébranlement devient «universel». La prophétie centrée sur la relation colonie-métropole se retourne vers l'Europe et son ordre social :
La mine est préparée sous les fondements de nos empires chancelants, les matériaux de leur ruine s'amassent et s'entassent, formés des débris de nos lois, du choc et de la fermentation de nos opinions, du renversement de nos droits, qui faisaient notre courage, du luxe de nos cours et de la misère de nos campagnes, de la haine â jamais durable entre des hommes lâches, qui possèdent toutes les richesses, et des hommes robustes, vertueux même, qui n'ont plus rien à perdre que leur vie.
Ces prédictions reçurent une amplification particulièrement éloquente dans le compte-rendu que l'abbé de Feller donna de la Révolution de l'Amérique, extrait de la troisième édition de l'Histoire des deux Indes, dans son journal historique et littéraire de novembre 1781 (p.315s)[22]. On sait que l'ouvrage reproduisait les quinze derniers chapitres du livre xviii et proposait, dans les limites d'un petit volume plus accessible, quelques-unes des provocations extrêmes de Diderot-Raynal, comme le faisait également le Tableau de l'Europe, vendu séparément. Par rapport à la totalité de l'Histoire des deux Indes, ces livres remplissaient aussi une fonction de vulgarisation.
G. de Froidcourt a raconté comment la Révolution de l'Amérique eut à Liège les honneurs de
la saisie. La Gazette
avait annoncé dans son numéro du 18 juin 1781 qu'on se la procurait chez «Orval Demazeaux, libraire de Son Altesse, sous
la Tour Saint-Lambert
». Le surlendemain, le journal informait ses lecteurs que l'avertissement avait été inséré «furtivement» par défaut de vigilance, et il ajoutait : «Le peu d'exemplaires qui se trouvaient ont été arrêtés et saisis.» Le synode, exacerbé, avait en effet agi dans ce sens auprès des autorités de police, représentées par celui qu'on a fastueusement appelé le «père de la Révolution liégeoise», Jacques Joseph Fabry — qui trouvait être un des «rédacteurs» de la Gazette — et par son fils Hyacinthe, auquel il venait de transmettre officiellement ses fonctions de mayeur en féauté (Harsin, p. 296). Averti, le prince-évêque Velbruck répondait au secrétaire du synode, malgré ses sympathies philosophiques : «Monsieur le bourguemaître Fabri a très bien fait de saisir les exemplaires de l'abbé Raynal. Recommandez-lui de veiller qu'on n'en vende pas à Liège[23].» Comment l'officine d'édition pirate qu'entretenait la principauté aurait-elle négligé un texte dont tout le monde parlait? P. Gossiaux a montré que Clément Plomteux, le principal contrefacteur de la cité avec Jean-François Bassompierre, avait donné au moins deux éditions de la Révolution de l'Amérique, dont il fait état dans sa correspondance avec la Société typographique de Neuchâtel dès la fin du mois de juin 1781[24]. Quelques jours après qu'on s'en soit pris à l'impression vendue par le libraire Orval-Demazeaux[25], «qui était également son homme à tout faire», Plomteux écrit à Neuchâtel qu'il prépare une seconde édition quasiment en présence de l'auteur, puisqu'il a eu «le bonheur» de le loger «depuis le moment de son départ de Paris» et qu'il vient «d'établir cet illustre proscrit à Spa où il prend les eaux». Gossiaux a identifié comme émanant de Plomteux une édition de 183 pages qui porte la fausse marque de «Londres, chez Lockyer Davis, Holbourn» (numéro 68 02 de Sabin; manque à Feugère[26]). La vignette de la page de titre (`barque à la voile ferlée') sert jusqu'à un certain point de marque distinctive, pour les éditions Plomteux de Raynal, qui sont loin de se limiter à ce texte.
C'est à la contrefaçon liégeoise que se réfère naturellement l'abbé de Feller quand il analyse dans son journal le volume sur l'Amérique, quelques mois plus tard. Son compte rendu témoigne d'abord de l'extrême popularité de l'œuvre et du choc produit par les événements d'outre-mer. «Déjà l'accueil qu'on fait à cette production monstrueuse doit être regardé comme l'avant-coureur sinistre des malheurs qui menacent l'administration.» On se moque de «quiconque tient encore aux principes d'obéissance et d'ordre». La disposition d'esprit des «prédicateurs de la révolte» est «devenue affreusement contagieuse» Et que dire de l'apologie de cette «nouvelle république de Boston qui exalte tant de cervelles»!
La contamination décrite par Feller peut bien sûr être exagérée. Mais l'important semble autant dans la fonction active du compte-rendu que dan son éventuelle vérité. La critique non seulement synthétise avec une grand clarté le projet déstabilisateur, mais elle lui emprunte sa forme, ses image dominantes, cette «véhémence de l'enthousiasme» dont l'abbé reconnaît bien la force et qu'il ne peut s'empêcher d'admirer. Le reflet négatif qu'elle offre est dirigé vers le même avenir pressenti. L'apostrophe au lecteur, la leçon faite aux rois, l'ironie, la «cadence harmonieuse» et «le faste des expressions», elle les assimile et prépare elle-même ce lecteur au style et aux secousses d'un monde nouveau. Elle renforce la vision d'un bouleversement inéluctable, à partir de la situation présente. Ne citons que deux passages caractéristiques (Mélanges, p. 503-505) :
Vous verrez, maîtres des nations, vous à qui le Ciel a confié le dépôt sacré de l'ordre et de la tranquillité publique, vous verrez les fruits amers d'une tolérance devenue pour vous une prévarication capitale, et pour vos peuples la source des calamités les plus désolantes. Peut-être flattés des démonstrations d'attachement et d'amour que vous recueillez dans vos provinces, regardez-vous comme des chimères les effets de l'insolence philosophique. Vous êtes aimés, dites-vous, l'affection de vos sujets vous sert de garde et de rempart. Je le veux. Mais après leur avoir fait tout le bien possible, ne peut-il pas vous venir à l'esprit de mettre un sol d'impôt sur le thé, le fard, la poudre rousse, ou quelque matière d'égale nécessité? Dès-lors vous n'êtes qu'un oppresseur, qu'un tyran. Les gens d'un grand sens qui ne voudront pas payer ce sol porteront partout le fer et le feu, vous conduiront à Tyburn comme le plus obscur des malfaiteurs, et leurs images seront placés dans le temple[27]. Ignorez-vous ce que c'est que les mouvements populaires; avec quelle facilité on leur donne les directions les plus opposées? Quand la statue de Georges III fut inaugurée à Boston, l'ivresse de ce peuple eût-elle permis de lui dire que dix ans après, on traînerait dans les boues cette même statue mutilée de la manière la plus ignominieuse?
Et l'adresse aux souverains conclut, en parlant de l'édifice formé par «la constitution des États, la sécurité des rois, la tranquillité des peuples, l'ordre et la dépendance qui font l'ensemble de tout ce que nous appelons corps civil et politique» : «La brèche est ouverte et prend d'un moment à l'autre des accroissements visibles, ses fondements se minent, à peine ses défenseurs osent-ils se montrer encore pour retarder une destruction entière. Quand il sera par terre, rois de l'Europe, songez à ma prophétie.»
3. «MORALE BARBARE» ET MORALISME BOURGEOIS
Le même numéro de la Gazette qui informait de la saisie de la Révolution de l'Amérique annonçait le 20 juin 1781 :
L'éloquent réquisitoire de M. l'Avocat général Seguyer contre l'Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes étant trop volumineux pour être inséré dans la Gazette de Liège, on l'imprime chez F.-J. Desoer, imprimeur, à Liège, in-8°; et l'édition en sera achevée pour vendredi prochain.
La brochure était en effet disponible le 22 juin et l'avis de la mise en vente, comme l'indique G. de Froidcourt, sera repris régulièrement.
Le public, de toute évidence, était impatient d'en savoir plus concernant Raynal. L'idée même de reproduire un texte comme celui de Séguier dans la feuille que publiait Desoer était inhabituelle. Le journal se montrait avare de nouvelles littéraires et n'avait certes pas coutume de leur donner tant d'importance. Les pamphlets soulignent sur le ton alarmiste qui était de circonstance que «l'impie» recueille alors à Liège l'adhésion d'un «nombre infini de jeunes insensé», qu'«un tas de partisans approuvent tous ses faits». Le journal de l'abbé de Feller ne pouvait manquer de reprendre à son tour le réquisitoire, qu'il publie in extenso[28].
Cet acte d'accusation portait exactement au but. On ne reprochera pas à Séguier d'avoir mal choisi ou tronqué les passages de l'Histoire des deux Indes qu'il cite. L'un d'eux se retrouve un peu partout. Il est tiré du chapitre sur la morale qui clôt le livre xix de la troisième édition, qui fut par ailleurs imprimé sous le titre de Tableau de l'Europe. Ce livre ne figurait pas dans la première édition, de 1770, mais on sait que celle-ci se rencontre augmentée d'une première version du Tableau, qui constitue alors un tome vii, daté de 1774 (Feugère, p. 16-21). C'est la formule que reprend le plus souvent la deuxième édition, lancée la même année. Le Tableau fut remanié pour la troisième et c'est parmi les additions que figure le passage incriminé.
Le dialogue entre Cadet et le Paysan le cite à partir de Séguier, à qui on emprunte son commentaire, légèrement modifié :
Un auteur aussi insensé [Raynal, bien sûr] oppose ensuite les préceptes indulgent : d'une raison égarée à la morale épurée de l'Évangile, pour mettre en comparaison un système destructif de toutes les lois avec le plan sublime de notre divine religion Plaignons un auteur qui ne s'attache à décrier la morale évangélique que parce qu'il n'a pas le bonheur d'en sentir toute la sublimité. À l'en croire, la religion chrétienne ne présente qu'une morale barbare, qui met les plaisirs qui font supporter la vie au rang des plus grands forfaits; une morale abjecte, qui impose l'obligation de se plaire dans l'humiliation; une morale extravagante, qui menace des mêmes supplices les faiblesses de l'amour et les actions les plus atroces; une morale superstitieuse, qui enjoint d'égorger tout ce qui s'écarte des opinions dominantes; une morale puérile, qui fonde les devoirs les plus essentiels sur des contes également dégoûtants et ridicules[29].
Le dialogue laisse tomber l'estocade finale : «enfin, une morale intéressée, qui n'admet de vertus que celles qui sont utiles au sacerdoce, ni de crimes que ce qui est contraire aux ministres de
la religion.» La
réprimande du Paysan se poursuit en reprenant et en assemblant vaille que vaille d'autres fragments du réquisitoire (où l'on retrouve même le nous oratoire de l'avocat général).
Le passage fait aussi l'objet de la proposition 52, dans la Censure de la Faculté de théologie de Paris contre Raynal. Ce concentré de son «venin» résumait en 84 articles «ce que l'impiété a vomi de plus horrible et de plus atroce» : «blasphèmes, descriptions obscènes, morale cynique, invectives contre les lois, principes de sédition et de révolte». Au plus fort de la campagne menée contre Bassenge, le censeur liégeois La Ruelle estimera au nom du synode qu'une réédition du recueil paraît «très-utile dans les circonstances présentes». La permission d'imprimer est datée du 18 octobre. Le 22, le libraire Lemarié peut annoncer dans l'inévitable Gazette, comme l'a aussi indiqué de Froidcourt, que son édition est prête et qu'elle se vend également chez son beau-père, le libraire de Boubers, reconverti dans une production plus orthodoxe que celle pour laquelle il avait été chassé de France[30]. Le tirage était épuisé une semaine plus tard, la Censure ayant rencontré «un succès au-dessus des espérances du libraire», et on en proposait une impression meilleur marché. On atteignait en 1782 la quatrième édition, à laquelle le beau-père mettait
la main. En
1785, Lemarié publiera encore Les quatre-vingt-quatre propositions extraites de l'Histoire philosophique de l'abbé Raynal, censurées et condamnées au tribunal de la religion et de la raison par Messieurs de la Faculté de théologie de Paris[31]. Le titre manifestait mieux ce que l'ouvrage était ou pouvait être en réalité, c'est-à-dire une introduction très pratique à la pensée de Raynal. Le nonce de Cologne y vit surtout quant à lui ce qui dessilla les yeux du prince-évêque. L'accueil fait au renégat l'inquiétait. Depuis quelque temps, de mauvaises langues dénonçaient systématiquement le laxisme de certaines autorités religieuses liégeoises. Quand l'évêque signa enfin le mandement condamnant l'Histoire des deux Indes, le nonce crut pouvoir se féliciter de l'effet produit par la «ristampa della censura della Sorbona[32]».
L'Analyse de François Bernard n'avait guère discuté le chapitre de la morale dans sa première version, qui offrait déjà les considérations les plus radicales, avec une orientation politique extrêmement franche. L'historicité de la religion, dont la fonction se réduisait toujours à «déifier les passions», y est opposée à l'universalité d'une morale naturelle définie par sa seule dimension sociale. «Être vertueux, c'est être utile.» La morale, «dont l'objet est la conservation et le bonheur commun de l'espèce humaine», est donc indissociable d'une politique. Son but et celui du bon gouvernement se confondent dans le «profit», l'«intérêt» collectifs. La critique de «cet état de guerre intestine qu'on appelle société ou gouvernement» est ici relativement poussée. Celui-ci est vicié dès qu'il n'a «pour base que l'intérêt d'un seul homme ou d'un seul corps». Il engendrera toujours la corruption «s'il est organisé de manière que l'intérêt momentané d'un seul ou d'un petit nombre puisse impunément prévaloir sur l'intérêt commun et invariable de tous» (édition d'Amsterdam 1774, vii.234-38). C'est le gouvernement, c'est la forme du pouvoir qui font les mœurs. L'avertissement adressé aux rois (on sait avec quelles menaces, dans d'autres passages) garde confiance dans leur sagesse : «Je n'ai pas cru que le saint respect que l'on doit à l'humanité pût jamais ne pas s'accorder avec le respect dû à ses protecteurs naturels.» Mais l'Histoire des deux Indes ne se termine pas moins, dans cette première édition, sur l'espoir d'une «heureuse révolution».
La réponse de François Bernard est caractéristique quand, de guerre lasse ou par maladresse, il se borne à relever des attaques mineures, somme toute négligeables par rapport aux «horreurs» débitées par Raynal concernant la «collusion sacrilège entre l'autel et le trône». Ce premier état du Tableau de l'Europe disait que la morale chrétienne n'était qu'un instrument, dans les mains des prêtres, pour devenir «les maîtres de régler toutes les actions des hommes» : «ils disposaient de toutes les fortunes, de toutes les volontés.» Mais l'Analyse préfère se scandaliser du passage sur les croisades, par lesquelles «toutes les passions s'allumèrent et s'exaltèrent entre les tombeaux de Jésus et de Mahomet». «Peut-on voir sans frémir», s'écrie le bon père, «le croissant de Mahomet à côté de la Croix de Jésus-Christ? peut-on voir confondre, sans frissonner, ces deux signes, si différents l'un de l'autre? Jamais l'impiété n'osa élever se tête aussi haut». Pour le reste, la réplique n'a pas d'autre recours que le contresens. Bernard reproche à Raynal d'avoir décrit l'histoire de la morale comme celle d'une «chose de pure convention», variant «au gré des différentes sociétés», ce qui est précisément le cas des idées religieuses, alors que «toutes les nations ont honoré comme des vertus la bonté, la commisération, l'amitié, la fidélité», etc.
La censure de la Sorbonne commet assez rarement ce genre d'erreur. Tout au plus peut-on lui reprocher, au chapitre de la morale, de feindre que les considérations portant dans l'Histoire des deux Indes sur «l'homme isolé» engagent aussi l'homme social[33]. Puisque le premier «a le droit ne vivre que pour lui seul» (proposition 60), les docteurs en déduisent que le second «pourra refuser des secours à l'indigent, s'il n'en attend aucun de lui», ce qui caricature la pensée de Raynal avec l'utilitarisme cynique prêté à Helvétius[34].
Dans cette section sur la morale, les censeurs accordent évidemment beaucoup d'importance à ce qui heurte la pudeur (on retrouve les provocations d'Helvétius), et c'est là ce que retiendront surtout les divers textes de vulgarisation dont il a été question. La propagande table sur un «moralisme populaire» ou «bourgeois» que vise aussi la troisième édition de l'Histoire philosophique, en introduisant un long passage qui stigmatise la «galanterie». Celle-ci était bien portée dans certains milieux — souvenons-nous du Préjugé à la mode de La Chaussée — tandis que la fidélité conjugale était volontiers laissée aux gens ordinaires, bornés aux petites vertus domestiques. Si les moralistes ont raison de déclamer contre la prostitution, écrit Diderot-Raynal (p. 289-93)[35], ils ne peuvent «rejeter toute la honte du vice sur la classes des femmes communes». À la femme galante ou «vaporeuse» qui prétendrait «s'honorer d'un commerce restreint», on rappellera que son vice est «gratuit», tandis qu'il s'explique ailleurs comme «réduit par la misère à exiger un salaire».
Les théologiens commenceront par dénoncer les idées qui les touchent le plus directement, en tant que prêtres. Raynal ne comprend rien au sens de la chasteté ecclésiastique (titre 1, propositions 48-51). Son impudeur se dévoile dès la fin du livre premier, dans le chapitre 22, sur le Japon (i.165-67). On n'y déplore pas seulement le sacrifice de la «jeunesse» et de la «beauté» mises chez les catholiques au service du culte, contre toute humanité. On y justifie l'usage d'honorer des courtisanes après les dévotions rendues aux dieux; le philosophe trouve de la sagesse dans un «culte de l'amour», sous certaines latitudes (propositions 53-55). La même «loi du climat» peut légitimer la polygamie dans ces pays chauds, comme le «droit public» d'une région particulière peut permettre l'adultère, qui n'était, à Sparte, qu'utilisation, «usufruit» du bien commun (propositions 62-64). Les écrits de propagande, alors, se déchaînent. Le projet de l'Histoire philosophique est d'installer «l'empire des passions». «Au lieu des temples consacrés au vrai Dieu, Raynal, l'abominable Raynal en élèvera d'autres sur leur ruine à l'impudique Vénus» (Dialogue). Les satires en dialecte reprennent d'une même voix, en montrant comment ses disciples invitent à viker corne lès bièsses, à «vivre comme les bêtes», sins honte èt sins pudeûr (Discours sur les esprits forts, p.120) :
I s'moquèt dè bon Diêm, dès profères èt dès sints;
i n'pinsèt qu'às bâcèles, à l'bone cîre èt l'bon vin.
Lès sèt pètchîs môrtéls fèt /'dogme di leû r'lidjon;
c'èst d'vins l'pagote Vénus qu'il-ont /'pus d'dévôcion.
Ils se moquent du bon Dieu, des prophètes et des saints;
ils ne pensent qu'aux filles, â la bonne chère et au bon vin.
Les sept péchés capitaux font le dogme de leur religion;
c'est envers la pagode de Vénus qu'ils ont le plus de dévotion.
Le Dialogue entre Cadet et le paysan développe le thème par une mosaïque de citations à nouveau empruntées au réquisitoire de Séguier. Si l'humanité annoncée par Raynal «vivra et mourra comme les bêtes», c'est qu'on lui aura enlevé la notion d'immortalité de l'âme, «qu'il appelle le fruit merveilleux de l'imagination, qui n'a été inventé que pour tourmenter l'homme depuis sa naissance jusqu'à la mort par la crainte des puissances invisibles» (Réquisitoire, p.12). La citation introduit alors la promesse d'un tout autre univers, bien séduisant, bien raisonnable, dans les termes de Raynal-Diderot :
Il trace enfin l'image de sa philosophie. Elle doit tenir lieu de divinité sur la terre: c'est elle qui lie, éclaire, aide et soulage les humains. Elle leur donne tout sans exiger aucun culte.
Elle demande, non le sacrifice des passions, mais un emploi juste, utile et modéré de toutes les facultés. Elle ne hait que la tyrannie et l'imposture, parce qu'elles foulent le monde.
Comment devait réagir le public à une doctrine présentée sous des couleurs si agréables? Dans l'Epite à l'fleûr dèl flate (Épître à la fleur de la bouse), une des chansons wallonnes suscitées par l'affaire Bassenge, les propos prêtés à celui-ci sont d'une gaieté trop communicative. Et les derniers vers ôtent beaucoup de son mordant à la dénonciation du philosophisme, quand ils opposent la «bonne humeur» aux réclamations toujours sombres du clergé. «Notre religion n'est qu'une momerie», fait-on dire à Bassenge, pour se scandaliser. Norte âme moûrt avou nosse cwér, l'âme meurt avec le corps. Que les sots s'effraient de ce que leur raconte le curé, avec son au-delà :
Por mi, ciète, dj'ènnè va m'trin,
dji n'hoûte nin cisse neûre sôrt di djins;
i n n'pârlèt qu'po leû profit,
n'vèyez-v» nin bin qu'il-ont minti?
Alez, divèrtihez-v» très bin :
ci sont zèls les pus grands colins.
Pour moi, certes, je vais mon train,
je n'écoute pas cette noire sorte de gens;
ils ne parlent que pour leur profit,
ne voyez-vous pas bien qu'ils ont menti?
Allez, divertissez-vous:
ce sont eux les plus grands coquins.
Aux accusations d'impudicité, le lecteur de la troisième édition de l'Histoire des deux Indes, quand il la compare aux précédentes, pouvait répondre que certains remaniements de 1780 manifestent un souci particulier de l'ordre moral dans le cadre des lois et usages établis. La fin du Tableau de l'Europe, dans la première version, distinguait l'aspiration légitime au plaisir et la «corruption» entraînée par «le goût des plaisirs». Ainsi, les croisades avaient dégradé les mœurs en excitant la recherche du «faste» et du «luxe». Ce dernier, avec son besoin d'«ostentation», est bien sûr spécialement condamné : il forme avec la «volupté» le double principe par lequel les richesses «corrompent et le citoyen qui les possède et le peuple qu'elles fascinent». Comme «les plaisirs» se transcendent en un plaisir isolé de tout ce qui peut le dégrader en affaiblissant l'homme, les «vertus» dont il est si souvent question dans le premier état du Tableau donnent lieu dans le second à une exaltation de la vertu, force au singulier qui domine désormais les autres qualités.
Définie comme identique à la justice, cette vertu retrouve tout son sens moral, sa signification sexuelle dans les considérations sur la femme mentionnées plus haut. Si l'Histoire philosophique a les idées larges en ce qui concerne la promiscuité dans l'utopie républicaine de Platon ou la «liberté de se prêter au désir de plusieurs hommes» sous des climats lointains, elle tient à réaffirmer, pour l'Europe, ce qu'elle appelle de manière tout de même significative «la propriété dans l'usage des femmes». Elle épuise également de façon typique, à leur sujet, le vocabulaire de la corruption, de la faiblesse à
la perversité. Ce
n'est pas pour rien qu'elle définit le devoir moral comme «l'obligation rigoureuse de faire ce qui convient à la société». La censure, qui ne voit que les provocations du texte et les images les plus scandaleuses, reproduit aussi un passage (proposition 64) qui va dans le sens d'une restauration de la morale conjugale, par le respect strict des «lois de l'État». À côté de ce que dénoncent en frémissant les censeurs effarouchés, il y a un moralisme de l'Histoire des deux Indes qui, peut-être, ne prépare pas seulement la «vertu» sociale de 1789, mais un certain rigorisme bourgeois auquel le dix-huitième siècle des Liaisons dangereuses n'était plus habitué. Le credo «famille-patrie» occupe l'essentiel des additions apportées en 1780 à la fin du livre (voir les réflexions sur le vrai sens de la «supériorité» nationale, ou la tirade contre ces citoyens «amphibies» qui «quittent leur pays sans regret» pour chercher fortune en courant le monde). Ces additions mettent dans une autre perspective le projet de société libérale qui fut d'abord celui de l'ouvrage, lorsqu'elles résument : «Le maintien de l'ordre, encore une fois, constitue donc toute la morale.»
En attendant, la philosophie nouvelle oppose surtout l'ordre d'une pensée nette, la rigueur des déductions tranchantes, à une critique souvent déclamatoire et tentée par l'invective pompeuse. Le contraste des manières est frappant, à l'intérieur même des écrits de propagande, quand ils citent l'ennemi. La différence entre celui-ci et la censure est aussi au premier plan affaire de langage.
4. LES DEUX VIOLENCES
On pourrait d'abord situer cette différence dans l'utilisation relative de certaines classes de mots. Usage qui reflète l'essentiel de l'affrontement jusqu'à engager son issue, en quelque sorte. Pratiquant une inflation de l'adjectif par défaut d'argumentation («orgueilleux perturbateurs», «affreuse production», «imagination infernale», etc.), le Dialogue entre Cadet et le paysan rend manifeste qu'il s'appuie tout entier sur une pure «image du monde» reçue et transcrite de manière passive, alors que le style verbal du discours philosophique se présente tout de suite comme un travail sur le réel : une autre vision des choses, mais décidément en marche. La seule arme de l'apologiste, grammaticalement parlant, c'est ce que les deux Indes appellent les «noirs crayons» de la religion.
Dans le camp adverse, la construction binaire ou symétrique des phrases, le retour de termes absolus («tout», «rien», «devoir») donnent le sentiment d'une pensée plus sûre d'elle-même. La maxime charpente ce «langage d'action» que reproduit le Dialogue :
L'impiété, l'audace, l'irréligion de l'auteur s'associent encore le mépris des souverains pour former un code barbare, qui n'a d'autre but que de renverser tous les fondements de la législation religieuse et civile. Le plan de cette affreuse production est la subversion de tout ordre. Les lettres et les arts, dit-il, décorent l'édifice de la religion, et la philosophie le détruit. L'imposture parle dans tous les temples et la flatterie dans toutes les cours. Tout écrivain de génie est magistrat né dans sa patrie: son tribunal est la nation entière, le public son juge, non le despote, qui ne l'entend pas, ou le ministre, qui ne veut pas l'écouter [tiré de Séguier, p. 15-16 et 201].
À cela, le conservatisme liégeois répond par une violence verbale qui parcourt tous les degrés de la répression, mais à l'intérieur soit de limites traditionnelles, chrétiennes et légales, soit d'un exercice de tonalité littéraire ou plaisante. On en appelle d'une part à des mesures qui se rangent sous là «correction» : la bonne vieille bastonnade, l'enfermement, l'exil. On voudrait traiter Raynal et les siens avou li spécifique d'on bon nièr de torê, avec le remède d'un bon nerf de taureau. Le même Discours sur les esprits forts propose :
Dji sé on bon moyin, si on m'volahe hoûter:
ci sèreût d'lès k'tchèssî ou bin d'lès rèssèrer,
èt haper tos lès /îves di cès r'nègâts-afreûs
po 'nnè fé dès hopês èt lès bouter è feû.
Je sais un bon moyen si on voulait m'écouter :
ce serait de les chasser ou bien de les enfermer,
et de prendre tous les livres de ces renégats affreux
pour en faire des tas et les bouter au feu.
La chanson en dialecte, parce qu'elle n'est que chanson, dans la langue excessive des disputes de la rue, peut aller plus loin et rêver de faire 'passer le goût du pain» à Raynal. Qu'il ait enfin ce qu'il mérite : èsse touwé come on malâde tchin, qu'il soit tué comme un chien malade (Li pwèrteû â sètch èt l'bouteû-foû, Le portefaix et le débardeur). Ailleurs, les souvenirs classiques seront invoqués. Les Grecs donnèrent le «bouillon d'onze heure» à l'hédoniste Aristippe. «N'est-ce pas là», demande le Discours sur les esprits forts, «un bel exemple qu'on devrait suivre en tout temps, pour entretenir la vertu chez les citoyens devenus les disciples de ceux qui veulent raisonner?» La menace ne peut sortir du discours d'école ou du recours aux gros mots, dans cette littérature patoise.
Dans l'autre camp, le langage est double, avec un rien de discordance. On affiche selon le moment la douceur et des sentiments plus rudes. D'un côté, on a beau jeu en effet d'opposer aux déchaînements de l'Église, outre sa doctrine même, certaines revendications mesurées des philosophes et la ritournelle d'un «Dieu rempli d'humanité». Parmi les quelques pièces liégeoises ayant pris la défense de Raynal et de Bassenge se détache une Épître aux fanatiques reproduite par de Froidcourt (p. 93-95), où est mis en vers le thème initial du chapitre de l'Histoire des deux Indes sur la morale.
Quoi? vous croyez que Dieu, tyran dur et bizarre,
punira ses enfants d'un châtiment barbare?
Ah! nous avons banni ces indignes terreurs,
la superstition enfanta les erreurs.
Le Dieu qui nous créa n'est point un Dieu terrible,
il n'est point comme vous implacable, inflexible.
Le Dieu que vos tableaux me forcent de haïr
nous fit pour nous aimer et non pour nous punir.
«Dieu de paix» au ciel, «philosophe en paix» sur la terre, malgré les complots. «Les sages de tout temps ont méprisé les fous.» Contre eux conspirent en vain les «bourreaux catéchisants» et le «frénétique dévot», avec leurs fers, leur rage, leur impatience «d'immoler». Ici, on parle vertus domestiques, amour de la patrie ou «douceur d'être père», quand il s'agit de condamner les «stériles vœux» du célibat. Dans la dispute de Cadet et du paysan, le curé Légipont introduit ce qui semble être un passage provenant d'un texte polémique perdu, écrit en faveur du «jeune frère» Bassenge. Cette défense ne manque pas de mettre en contradiction les sentiments chrétiens et la pratique :
Paul Cadet va parler furieusement de charité. On dirait qu'il en est tout plein. Mais, dit-il, il ne fallait pas, comme je l'ai dit ci-dessus, blesser
la charité. La
charité, mes frères, voilâ à quoi il en faut revenir. Vous avez diffamé le jeune frère. Vous avez juré de le perdre. Vous avez cherché â porter la désunion dans le sein de sa famille. Vous avez voulu le brouiller avec ses amis; vous avez menacé ceux-ci de votre vengeance, et tout cela sous prétexte de la religion, sous prétexte de défendre la cause de Dieu. Quel blasphème, mes frères! Quoi! ce Dieu de paix et de miséricorde vous a-t-il commandé une aussi absurde persécution?
Pouvait-on être plus éloquent, et d'un ton plus vrai? Une autre citation de l'Histoire des deux Indes fait écho à ces réclamations dans le Dialogue, inscrivant le principe de mesure à l'intérieur de l'expérience vécue. Ce que recopie le curé-censeur parle d'une philosophie « qui lie, éclaire, aide et soulage les humains».»'Elle leur donne tout sans en exiger aucun culte. Elle demande, non le sacrifice des passions, mais un emploi juste, utile et modéré de toutes les facultés. Elle ne hait que la tyrannie et l'imposture, parce qu'elles foulent le monde.» Séguier devait convenir que ces dernières lignes, en soi, sans les excès qui les accompagnent chez Raynal, avaient de quoi séduire «tout homme vertueux». En somme, la censure qui les isole les rendait nettement plus acceptables.
La patience que montre Bassenge a pourtant ses limites. Légipont présente «l'acteur dans sa dernière scène», «saisi de nouveaux accès», et cite un autre passage de ce que nous croyons être sa défense perdue :
Le feu pétille dans son imagination: il en sort des éclats mêlés de noires vapeurs, et il s'imagine d'avoir soufflé la rage au paisible troupeau. Repentez-vous, mes frères, dit-il, profitez du temps de la neuvaine de saint Hubert, priez-le pour votre guérison. Alors â tout péché miséricorde. Mais pour peu que vous continuiez dans votre impénitence, alors, â l'exemple de mon prédécesseur saint Paul, qui quelquefois n'était pas tendre, je tonnerai contre vous, j'arracherai tout le voile, dont je n'ai soulevé qu'un petit coin. L'on connaîtra les masques et les insectes[36].
À bout d'invention, l'apologiste retourne aux vieilles machines pour l'imprécation finale : «L'impénitence est le dernier mot de
la pièce. Les
éclairs, qui la suivent, menacent de tonner, foudroyer, briser tout.»
Les menaces des philosophes sont quant à elles d'une autre trempe, une fois remisées «douceur» et «modération». Elles se concentrent en quelques images : «chaîne de fer» de l'autorité de droit divin (proposition 72 de la censure des théologiens); «bayonnettes dirigées vers la poitrine ou la tête sacrée de l'Empereur», en Chine, pour y garantir la liberté du peuple (proposition 82)[37]; usage «salutaire», à Ceylan, de condamner à mort le roi qui viole la loi (proposition 81; i.107). Cette coutume donne lieu à une formule de Diderot dont Benot a noté la réapparition dans l'Histoire des deux Indes[38] et qui va particulièrement impressionner Légipont, comme Séguier. La loi doit être «un glaive qui se promène indistinctement sur toutes les têtes, et qui abat ce qui s'élève au-dessus du plan horizontal sur lequel il se meut». Au Mexique, un commandant fait saisir un coupable avéré dans une église, malgré le droit d'asile. Diderot dénonce toute forme d'usage permettant d'échapper à une 'justice due également et sans distinction à tous les citoyens'. La protection que constitue l'habit ecclésiastique est spécialement visée. «Si le glaive de la loi ne se promène pas indifféremment partout; s'il vacille; s'il s'élève ou s'abaisse selon la tête qu'il rencontre dans son passage, la société est mal ordonnée» (livre vi, chapitre 13).
Même comparaison, mais plus interrogative, lorsque sont discutées les notions d'égalité naturelle et artificielle, dans les réflexions sur la révolution américaine (livre xviii, chapitre 42). Les «fondateurs des nations» ont senti, les premiers, la nécessité de soumettre «sans exception les membres d'une société à une seule autorité impartiale». «Mais ce glaive était idéal. Il fallait une main, un être physique qui le tint. Qu'en est-il résulté? C'est que l'histoire de l'homme civilisé» — formule fameuse — «n'est que l'histoire de sa misère». De ce passage quelque peu allusif, on ne peut guère comprendre que ceci, en prolongeant la pensée de Diderot. S'il faut se contenter, par réalisme, de viser l'égalité artificielle, puisque la nature nous a faits «éternellement» inégaux, il convient de donner à cette recherche et à ce but le maximum de réalité, faute de quoi on piétine dans «l'histoire de la misère». Une égalité illusoire (on songera plus tard au rapport entre égalité légale et économique) engendre à la longue les mêmes troubles que l'état de franche inégalité. C'est à une conclusion identique, politiquement extrême, qu'aboutit Diderot dans la célèbre comparaison du sauvage et de l'homme «policé» : «Les gouvernements mitoyens laissent entrevoir quelques rayons de félicité dans une ombre de liberté», mais c'est en vain que «l'habitude, les préjugés, l'ignorance et le travail abrutissent le peuple jusqu'à l'empêcher de sentir sa dégradation : ni la religion ni la morale ne peuvent lui fermer les yeux sur l'injustice de la répartition des maux et des biens de la condition humaine, dans l'ordre politique» (livre xvii, chapitre 4).
«Histoire de la misère», dont «toutes les pages sont teintes de sang». Celui-ci est omniprésent dans l'Histoire des deux Indes. C'est le terme central, unifiant, de beaucoup de passages importants : «pas rapides et ensanglantés» des barbares Européens, «champs américains enivrés» du sang des colons esclavagistes, «bains de sang» où s'achève l'aventure des deux nègres de Saint-Christophe (anthologie de Benot, P. 48-49, 202, 259-5i, 295, etc.). Il y a dans l'Histoire philosophique, et spécialement dans les interventions de Diderot, une représentation et un vocabulaire de la souffrance, de la cruauté qui mériteraient d'être étudiés. La fin du chapitre sur les sauvages du Canada (livre xv, chapitre 4), avec sa description complaisante des «plus cruels tourments» et mutilations qu'on y inflige aux prisonniers, illustre bien cet aspect. «C'est le sublime de la nature dans ses horreurs et ses beautés», entourées d'ossements et de chaînes qui font quelquefois pencher l'œuvre vers le roman noir. À cette «férocité» de l'Histoire des deux Indes répond l'image même de leur auteur, qui a osé mettre son nom et son portrait en tête de la troisième édition. Un plumitif liégeois commente celui-ci d'un quatrain typique[39] :
Quel est ce vieux barbon qu'on a daigné port raire: quel front sombre et farouche! et quel air infernal!
Est-ce quelque assassin ou quelque incendiaire? C'est encore bien pis, car c'est l'abbé Raynal.
Les propositions que condamne pour terminer la Censure de la Faculté d théologie se détachent sur ce fond dramatique avec la force des slogans, ou la froideur des vérités à venir, telles que peut en apercevoir l'homme «élevé au dessus de toutes les considérations humaines», avec «le globe au-dessous de soi». Appliquées à la situation en Amérique, elles étendent à l'Europe le principe de la mort légitime. Partout, « le tyran est un monstre à une seule tête qu'on peut abattre d'un seul coup» (réminiscence antique, dans le chapitre 42 du livre xviii : Les colonies étaient en droit de se séparer de leur métropole). Et «l'homme qui a de bons yeux» ne distingue pas seulement en Chine la «tête hideuse» du despotisme. Pour ceux qui n'auraient pas compris, les théologiens de Paris mettent le propos noir sur blanc. Puisque Raynal (p.163-64)
ne nous représente point l'Empereur de la Chine comme un tyran plus féroce que tout les autres, qui fasse gémir ses sujets sous un joug plus dur ce n'est point uniquement à l'Empereur de la Chine, mais à tous les Princes et â tous les Rois qu'il veut que let peuples montrent les remparts, qu'il prétend être les seuls, de leur liberté, c'est-à-dire des lances, des épées, des bayonnettes.
Sans ces «remparts», le contrôle populaire est un vain mot. Les occasions de l'exercer contre le despote n'ont pas dû manquer, «à la Chine». Et pourtant, «y a-t-il eu un grand nombre de tyrans déposés, emprisonnés, jugés, mis à mort»? Le passage se termine comme on l'attendait. «Voit-on sur la place publique un échafaud sans cesse dégouttant du sang des souverains? Pourquoi cela n'est-il pas?»
Comment, aussi, ne pas détacher avec les censeurs cette proposition 79 qui conclut dans l'Histoire philosophique le chapitre consacré à la politique européenne?
La liberté naîtra du sein de l'oppression, elle est dans tous les cœurs. Elle passera par les écrits publics dans les âmes éclairées, et par la tyrannie dans l'âme du peuple. Tous les hommes sentiront enfin, et le jour du réveil n'est pas loin, ils sentiront que la liberté est le premier don du ciel.
5. CONCLUSION
Dans ce qui précède, on s'est plus spécialement attaché à deux idées qui relèvent, d'une certaine manière, d'évidences historiques anciennes, exprimées par des contemporains de Raynal eux-mêmes. Les «effets pervers» de la censure ont été cherchés non seulement dans la publicité donnée à certains textes de l'Histoire des deux Indes, mais dans la manière dont s'est constitué et transmis, de la censure officielle vers d'autres «vulgarisateurs», un stock de citations et «images tirant leur impact de trois éléments : leur contraste interne (humanité/violence); celui qu'elles forment avec le style clérical et sa violence propre; et quelquefois, leur découpage en propositions isolées, rendues plus acceptables qu'elles ne l'étaient dans le contexte radical de l'Histoire des deux Indes. On a d'autre part émis l'idée d'un recoupement objectif, pas nécessairement délibéré ni même tout à fait conscient chez une partie des lecteurs, entre telles positions de Raynal sur l'Amérique et l'environnement culturel quotidien que pouvait représenter un journal comme la Gazette de Liège, qui est, de tous les périodiques imprimés dans la région, celui où la part de la réflexion et du commentaire est la plus mince.
La vulgarisation par l'Église a été ironiquement évoquée par Raynal lui-même dans la Réponse à la censure de la Faculté de théologie de Paris (s'il en est bien l'auteur; Londres 1781). On ne peut mieux faire que de citer à nouveau l'«Avis au peuple» placé en tête du volume, où est indiqué franchement le but des «pensées philosophiques» contenues dans l'Histoire des deux Indes, qui est d'«éclairer les hommes sur leur excellence» et de «leur montrer l'abus étrange qu'ont fait en tout temps de leur pouvoir ceux qui se sont arrogés le droit de les gouverner, surtout quant au spirituel».
Cet ouvrage, précieux pour l'humanité, ne pouvant manquer de déplaire à ceux qui ont le plus grand intérêt de profiter de notre aveuglement, vient d'être proscrit par le Parlement et la Sorbonne, ce qui le rend sinon rare, au moins d'une cherté excessive. Mais consolons-nous; la même main qui a fait le mal nous en apporte le remède et le bien nous vient du côté d'où nous n'aurions jamais osé l'attendre. La Faculté de Théologie de Paris, qui sûrement ne pense plus comme du temps d'Henri IV, sentant mieux que personne l'utilité de ce livre, et voulant soulager la partie la plus pauvre des hommes qui n'aurait jamais pu se le procurer, a pris le parti, sous prétexte d'en faire la censure, de nous en extraire le meilleur, et de le rendre public en vertu de son privilège. Ainsi, grâce à ses soins, nous aurons le suc des pensées de M. l'abbé Raynal, sans être obligé d'acheter dix gros volumes in-octavo; et pour la commodité de ceux qui ne savent pas lire, et qui, pour cette cause, n'auraient jamais su s'il existait un Guillaume-Thomas Raynal, les curés ne manqueront pas d'en faire la lecture aux prônes et dans leurs sermons.
Nous ne savons pas si un Légipont a lu au prône les passages de l'Histoire des deux Indes qu'il insère dans son dialogue. Nous ignorons quel statut y occupe vraiment le paysan représentant «ceux qui ne savent pas lire» : simple type symbolique ou sorte de destinataire potentiel? Mythe et refuge d'une piété naïve, à l'usage d'un curé dont la foi se sentait abandonnée, ou interprète d'un public populaire auquel on s'adresse effectivement? Ce public apprit en tout cas qu'il «existait un Guillaume-Thomas Raynal» par le mandement lu le 28 octobre «dans toutes les églises de notre cité de Liège», relu le dimanche suivant pour plus d'efficacité et reproduit dans les journaux, dont la Gazette de Cologne.
Approuvé par certains, il fut critiqué par d'autres. Les «gens sages» blâmaient un pareil éclat et réprouvaient les imputations d'homme turbulent assez audacieux que d'oser publier, par une témérité inouïe, une pièce de vers insultante pour tous genres d'autorité; les modérés n'approuvaient pas davantage la menace de punir l'auteur de la Nymphe de Spa selon la rigueur des lois. Ce « diable de mandement» fit en tout cas « un bruit terrible dans la ville et les environs[40]».
La Lettre de l'abbé Raynal â l'auteur de la Nymphe de Spa, probablement rédigée par Bassenge ou dans le cercle de ses sympathisants, demandera aux «Busiris en soutane», aux «pygmées» responsables de la «singerie» : «Pourquoi tant de bruit sur un objet qui selon vous doit attirer à l'auteur l'animadversion générale? vous ne voyez pas que vous accélérez sa célébrité» (p. 22).
Raynal et les révolutions du dernier quart de siècle sont d'autre part unis par une forte dialectique où la réputation du «célèbre» auteur s'abstrait des complexités ou contradictions du texte de l'Histoire des deux Indes et se radicalise dans
la polémique. Paine
et Mazzei vont émettre de sérieuses réserves sur son discours pro-américain. La troisième lettre du Raynal démasqué pourra écrire «qu'il n'a pas été plus favorable aux Américains» qu'aux révolutionnaires français de 1791, «qu'il les a vus avec regret secouer le joug de l'Angleterre, et se donner une constitution». Mais pendant longtemps, pour un public qui se souviendra surtout, en matière d'attitude envers les colonies, des deux premières éditions de l'Histoire philosophique, il sera le partisan des insurgés, pour ne pas dire, comme le fait avec sa fougue habituelle l'abbé de Feller, un des artisans de l'insurrection[41] :
Si l'on demande d'où vient cet enthousiasme plus que plaisant de Mr. Raynal pour la révolution d'Amérique; je le dis en un mot. C'est qu'il la regarde comme son ouvrage; comme l'effet des sarcasmes salutaires dont son livre est assaisonné. Plus de 25 mille exemplaires de l'Histoire philosophique ont été distribués parmi les colons anglais; les maximes de l'auteur ont été répétées, préconisées dans toutes le gazettes et journaux du pays. Il est même apparent que ce n'est que dans cette vue qu'il a écrit l'Histoire de la Révolution.
Habitué aux exercices de l'almanach de Mathieu Laensberg, la production nationale par excellence, Feller poursuivra :
O! si la triste manie des prédictions politiques me prenait un jour, qu'il me serait aisé d'annoncer des choses plus certaines, mais aussi plus effrayantes pour les peuples et les rois! Que les ennemis de l'autorité jouissent encore quelque temps de l'impunité de leur audace; que le code de l'anarchie soit plus connu et plus accueilli des nations; que le pouvoir légitime ait acquis quelques degrés de haine de plus…
Rétrospectivement, le Journal général de l'Europe écrira aussi en 1790, dans un article sur les Révolutions : «Les Américains ont été nos précurseurs, sinon nos maîtres, dans ce grand art qui enseigne aux peuples l'étendue de leurs droits, aux souverains celle de leurs obligations, qui fixe les limites du pouvoir et celles de l'obéissance[42].» Une autre recherche devrait s'attacher à la présence de Raynal dans ce qui unirait les révolutions américaine et liégeoise. On peut être assuré de
la filiation. Ce
n'est pas pour rien qu'un des meneurs liégeois de 1789, Jean-Pierre Ransonnet, qui conduisit la prise de la Citadelle, avait fait ses classes dix ans plus tôt avec les troupes du Congrès.
Cet «exalté d'américanisme», peut-être un peu hâbleur, à la mode du pays, proposait dès 1787 de régler à sa façon le sort d'un prince-évêque ayant choisi l'affrontement avec ce qui restait d'institutions démocratiques, dans un pays habitué à certaines instances de recours contre les abus du pouvoir[43]. «Qu'on abandonne la sainte écriture et les plaideurs à leurs rêveries, ce sont des armes rouillées.» Les «bonnes» se trouvaient chez son ami Gosuin, le marchand de fusils. «Des procès! des enquêtes! C'est la guerre des lâches.» L'exemple de Bassenge suffirait à montrer que Ransonnet ne fut pas le seul chez qui l'action sut se mettre à la hauteur de l'«ivresse rhétorique», communiquée ou non par Raynal-Diderot, mais attachée à leur œuvre, par les contemporains, comme une de ses marques les plus essentielles.
[*] Paru dans Studies on Voltaire 286. 1991.
NOTES
[1] P. 343-44, réponse surtout au compte rendu de R. Mortier, Revue belge de philologie et d'histoire 49 (1971), p. 892-901.
[2] H.J. Lüsebrink, «Lexicologie et pragmatique historique du texte: questionnements à partir de l' Histoire des deux Indes», Traitements informatiques de textes du 18e siècle, éd. A.-M. et . Chouillet (Saint-Cloud 1984), p. 129.
[3] Benot, p. 172-173, 181.
[4] « Vous êtes étonné, Monsieur, que Raynal, cet apôtre de la liberté, cet homme dont on a dit qu'il pourrait professer les insurrections, se soit déclaré contre la révolution française» ( G. T. Raynal démasqué, ou lettres sur la vie et les ouvrages de cet écrivain, s.l. 1791, lettre III, p.23). Ce pamphlet vise son adresse à l'Assemblée nationale du 31 mai 1791.
[5] Voir Livres et Lumières au pays de Liège (Liège 1980).
[6] L'Abbé Raynal au pays de Liège (1781) (Liège 1946), et «À propos de L'Abbé Raynal au pays de Liège», La Vie wallonne 22 (1948), p. 37-39; P. Harsin, «Encore l'affaire Velbruck-Raynal-Bassenge», La Vie wallonne 23 (1949), p. 57-62, reproduit dans Recueil d'études (Liège 1970), p. 295-302.
[7] «Je me rappelle le mot d'un homme de lettres connu, à qui l'on demandait pourquoi l'abbé Raynal avait signé son livre, et s'était mis dans le cas de fuir sa patrie. Il répondit : C'est qu'il est las et humilié de vivre avec les auteurs de son ouvrage» (p. 8).
[8] Lettre de M. l'abbé Raina/ à l'auteur de la Nymphe de Spa; précédée d'une lettre de
la veuve Bourguignon
, imprimeur de S.A.C. Mgr. le Prince Evêque de Liège, à M. G*** son confrère à… (La Haye 1781), p. 13. Lettre sans doute apocryphe et qui doit émaner des milieux liégeois.
[9] Annuaire d'histoire liégeoise XIV/38 (1973), p. 103-128.
[10] «Contestataires et apologistes au XVIIIe siècle. Pour une nouvelle lecture de quelques écrits de Gilles Légipont», Livres et Lumières, p. 51-72.
[11] Livres et Lumières, p. 63.
[12] Reg. par. 149, p. 120. Ce registre montre plusieurs lacunes. Ainsi, le début du Dialogue fait défaut.
[13] En général, on ne séparera pas systématiquement, dans ce qui suit, les interventions de Diderot et le texte de Raynal, sur quoi on renvoie aux travaux de M. Duchet et G. Goggi (voir de ce dernier, «Les manuscrits des contributions à l' Histoire des deux Indes et le choix d'un critère d'édition», Diderot : autographes, copies, éditions, éd. B. Didier et
J. Neefs
, Vincennes 1986, p. 93-113).
[14] P. 17 de l'édition d'Amsterdam; voir ci-dessous.
[15] Février 1775, p. 229-40; mars, p. 320-27. Voir R. Trousson, «L'abbé de Feller et les philosophes», Études sur le XVIIIe siècle 6 (1979), p. 103-115.
[16] En particulier la Vie du pape Clément XIV, qui fut abondamment éditée à Liège, y compris sous l'adresse de Paris : Gazette des 23, 25 et 30 janvier, 15 février 8 et 12 mai.
[17] «Naissance d'une nation», La Vie wallonne 56 (1982), p. 31-46.
[18] Pour la première édition, on utilise une impression d'«Amsterdam, 1774» qui correspond en gros à celle d'«Amsterdam, 1773» décrite par A. Feugère sous le numéro 33, Bibliographie critique de l'abbé Raynal (Angoulême 1922). Les passages en question se trouvent au tome vi.556s.
[19] Les additions et variantes de cette deuxième édition (1774) furent reprises systématiquement par l'imprimeur maastrichtois Jean-Edme Dufour dans un Tome septième de l' Histoire des deux Indes paru la même année pour servir de supplément à l'édition publiée en six volumes, sous le titre d'Amsterdam, 1773, et qui contenait aussi le Tableau de l'Europe (Stadsbibliothek Maastricht. CB
245.C.7). Les renvois correspondent, pour la pagination, à l'édition décrite par Feugère sous le numéro 31, «Amsterdam, 1772»; celle-ci se trouve également à
la Stadsbibliothek Maastricht.
[20] Pour la troisième édition, on se sert de celle donnée à Liège par Clément Plomteux sous la fausse marque «Genève, Pellet» (voir P. Gossiaux, dans le catalogue de l'exposition Le siècle des Lumières dans la principauté de Liège, Liège 1980, notice 221). Notre exemplaire, dont les dix volumes sont datés de 1782, correspond au numéro 54 de Feugère sauf pour le tome i, qui correspond au numéro 52, daté de 1781. Ici, ix.144-p45.
[21] Première édition, p. 580-82.
[22] Réimprimé dans les Mélanges de politique, de morale et de littérature extraits des journaux de M. l'abbé de Feller (Louvain 1822), i.486-513.
[23] Lettres autographes de Velbruck, éd. G. de Froidcourt et M. Yans (Liège 1955), 2.70-71. Voir aussi Th. Gobert, «L'abbé Raynal et Velbruck», Leodium x/12 (1911), p. 134.
[24] Siècle des Lumières, notice 220.
[25] Voir M.-Fr. Gérard, Aspects de l'édition et de la librairie à Liège sous le règne de Ch.-N. d'Oultremont (1763-1771) (Liège 1978), p. 51.
[26] Feugère n'a pas utilisé la bibliographie extrêmement riche de J. Sabin, A dictionary of books relating to America (New York 1868s.), xvi.364-73. Ainsi, il ne mentionne que quatre éditions «londoniennes» de la Révolution; Sabin en a huit.
[27] On reconnaît certains des passages le plus provocateurs de l' Histoire des deux Indes, livre ami : « J'ai entendu dire à un Whig, fanatique peut-être; mais il échappe quelquefois aux insensés des paroles d'un grand sens: je lui ai entendu dire; que tant qu'on ne mènerait pas à Tiburn un mauvais souverain, ou du moins un mauvais ministre, avec aussi peu de formalités, d'appareil, de tumulte et de surprise qu'on y conduit le plus obscur des malfaiteurs, la nation n'aurait de ses droits, ni la juste idée, ni la pleine jouissance qui convenait à un peuple qui osait se croire ou s'appeler libre» (éd. Plomteux, ix.159). « Si l'apothéose est due à l'homme, c'est à celui sans doute qui combat et meurt pour son pays. Mettez son image dans vos temples, approchez-la des autels. Ce sera le culte de la patrie» (ix.169-70). Ce passage figure dans le choix d'extraits de l'Histoire des deux Indes procuré par Y. Benot (Paris 1981), p. 326-335.
[28] Juillet et août 1781, p. 379s., 454, 541s.; Mélanges, i.402-415. En août, le Journal historique et littéraire fait écho à la protestation de la compagnie des pasteurs et des professeurs de Genève contre la réédition de l' Histoire des deux Indes par Pellet, qui «ne s'est pas fait scrupule de se nommer, et de prendre le titre d'imprimeur de l'académie», sans se soumettre à leur censure «ou à celle de l'académie» ( Mélanges, p. 439-40). En octobre, il évoque le mandement de l'archevêque de Vienne contre Rousseau et Raynal (p. 483-486).
[29] Dialogue, p. 118-19; on rétablit une orthographe et une ponctuation modernes, ainsi que l'italique qui est chez Séguier ( Réquisitoire, éd. Desoer, p. 19).
[30] Voir notre «Voltaire et l'édition liégeoise jusqu'en 1765», Livres et Lumières, p. 141ss.
[31] Ces deux dernières éditions : Bibl. Univ. de Liège, Chauvin 1552.B et 1374.B.
[32] Harsin, p. 298-99. On réserve pour une autre publication cette question des attaques portées contre la manière dont on favorisait, à Liège, l'irréligion tout en tracassant un militant comme Feller. Celui-ci avait des raisons de se plaindre. Resterait à examiner celles qui permettraient de croire à la duplicité du vicaire général, chef du synode, le comte de Rougrave. De son côté, le prince-évêque nous montre, dans sa correspondance, une partie du synode jouant «derrière la toile». Mais le texte en question est difficile à interpréter, bien que l'ensemble de la correspondance reproduite par de Froidcourt tende à imposer une lecture différente de celle qu'a choisie Harsin, pour qui Rougrave et le secrétaire du synode, le chanoine Delatte, seraient naturellement dans le camp des ennemis de la philosophie.
[33] Addition de la troisième édition, x.280ss.; Censure, p. 134 et t42.
[34] Dans leur conception théoriquement indivisible du bonheur collectif, «d'une lutte commune contre les dangers communs», les auteurs de l' Histoire des deux Indes avaient pourtant pris soin de placer des mots assez durs pour «l'avarice jalouse et l'ambitieux orgueil». L'Église envisage l'égoïsme comme faute personnelle et Raynal dans son fonctionnement général. Là est toute la différence.
[35] Voir spécialement M. Duchet, Diderot et l'Histoire des deux Indes , ou l'écriture fragmentaire (Paris 1978), p. 104-105.
[36] Cette dernière expression, qui reprend celle d'«insectes obscurs» appliquée aux ennemis de Raynal dans la Nymphe de Spa, l'épître adressée à celui-ci par Bassenge, apparaît ailleurs dans le dialogue, tendant à montrer que les «citations» faites par Légipont doivent être authentiques.
[37] Pris au chapitre 21 du livre 1, dans la troisième édition, État de la Chine selon ses détracteurs (i.151); anthologie de Benot, p.38-39.
[38] P. 167, 200 et 238. Édition Plomteux, 111.272 et ix.156-57; anthologie de Benot, p. 323-325.
[39] Cité par de Froidcourt, p. 67-68; D. Malherbe, Les Infiniment-petits de la littérature (Liège An xi-1803), p. 65.
[40] De Froidcourt, p. 61. J'avoue ne pas voir d'où Froidcourt tire ces informations sur les réactions au mandement.
[41] Mélanges, p. 501-502. Pour l'influence de Raynal sur ceux qui préparèrent la constitution de 1787 et sur les «éducateurs de la jeune république» en général (Noah Webster, Robert Coram), comparer H. F. May, The Enlightenment in America (Oxford 1976) et J. P. Greene, The lntellectual heritage of the constitutional era. The delegates' library (Philadelphia 1987), p. 42. Notons qu'il est aujourd'hui d'usage, en tous cas chez les historiens d'outre-Atlantique, de souligner la dualité de Raynal, quand il s'exprime dans la ligne de Buffon sur les «Américains» autochtones, les Indiens débilités par le climat, et sur l'avenir du continent, où certains plaçaient, avec Turgot, «l'espoir de la race humaine». Voir H. S. Commager, The Empire of reason: how, Europe imagined and America realized the Enlightenment (Oxford 1982), spécialement le chapitre «The Enlightenment vindicates America».
[42] Cité par Comoth.
[43] A. Borgnet, Histoire de la révolution liégeoise de 1789 (Bruxelles 1973), i.31 et 47s.; J. Bosmant, Les Grands hommes de la révolution liégeoise de 1789 (Liège 1939), p. 46-49. B. Addison, qui a bien voulu discuter avec moi le présent article, me signale divers échos de la révolution américaine dans la principauté, dont des Couplets en dialogue chantés pour la première fois à Spa le 13 février 1783 au sujet d'une mascarade analogue en réjouissance de la paix d'Amérique, attribués à un certain Pascal Wilkin (de Theux, Bibliographie liégeoise, Bruges 1885, p. 684). Ce dialogue aurait notamment été «débité», selon A. Body, par l'avocat Deleau, un des personnages en vue du parti réactionnaire, lors des événements de Spa qui préludent à
la Révolution. L'Élégie
sur l'avocat Deleau lui prête les propos suivants (A. Body, Recueil de vers, chansons et pièces satiriques sur la révolution liégeoise de 1789, Liège 1882, p. 35-36) : «Foin de vos cris, / peuple qui trouvez à redire, / foin de vos cris; / vous êtes faits pour obéir. / Que l'on s'avise de médire / sur nos gérés, sur notre dire, / foin de vos cris!» | |



|




